Merci à vous tous d’être là à l’occasion du lancement de La grande tribu, c’est la faute à Papineau.
Je vais essayer d’être bref mais comme vous savez, c’est parfois long de faire court.
Il y aura bientôt cinquante ans que j’écris. Mon premier roman, je l’ai rédigé à l’âge de 14 ans, et depuis je n’ai pas cessé d’aligner des mots sur de grandes pages blanches.
Pourquoi je l’ai fait ? Pour moi-même d’abord et pour prouver que dans un semblant de pays comme le nôtre, qui proclame l’égalité des chances pour tous, mais pratique le contraire, il est possible, même dans la pauvreté sociale et culturelle, d’entreprendre long et profond.
Pour tout vous avouer, je rêvais alors d’être le premier Québécois à recevoir le prix Nobel de littérature. Dès qu’il a commencé à boxer Mohamed Ali a dit : « Non seulement je serai champion du monde, mais le plus grand de tous les champions. » En l’entendant, je me suis dit : « Pourquoi je ne pourrais pas devenir moi aussi champion, et le plus grand des champions ? » Et puis, William Faulkner n’a-t-il pas dit aussi : « Il faut avoir un projet si vaste qu’on ne peut plus le perdre de vue. »
Quand, malgré les réticences de René Lévesque, Camille Laurin a réussi à faire adopter le projet de loi 101 qui faisait de la langue française la seule langue officielle du Québec, j’ai encore rêvé qu’un jour je lui ferais hommage en faisant paraître un cent et unième ouvrage de moi. Je rêvais toujours que cela pourrait coïncider avec ce moment fabuleux où nous célébrerions le vingt-cinquième anniversaire de notre indépendance nationale.
Près de cinquante ans après m’être mis par l’écriture à rêver et à agir, je constate que nous n’avons jamais été aussi loin de l’indépendance que nous le sommes actuellement : nos élites n’ont jamais été aussi veules, même dans les chartes qu’elles nous ont imposées et qui consacrent le seul droit que nous avons encore, celui d’être aliénés ou aliénables.
Fini l’unilinguisme de la Loi 101. Bienvenue au bilinguisme pour tous et, pourquoi pas, au multilinguisme. On ne sait pas apprendre à nos enfants ni à lire ni à écrire le français, mais c’est parce qu’on a besoin d’être immergés, non pas dans la langue de Molière, de Tremblay ou de Lepage, mais dans la mer anglophone.
Pour ces étranges mondialistes-là, on ne devrait même plus avoir de relations privilégiées avec la France. Voyez-vous, elle n’a plus rien d’un empire, tandis que les États-Unis en sont un. Bien sûr, on est contre les guerres que provoque l’empire le plus militaire qu’on ait eu à subir sur la planète, mais qu’importe ! C’est avec l’empire qu’on fait de l’argent.
Demain, on apprendra le mandarin et le cantonais pour les mêmes raisons, non pas pour mieux communiquer culturellement avec le monde comme le prétendent les mondialistes, mais pour mieux y faire de l’argent sale, comme c’est le cas avec le Canada qui, depuis le début de la guerre en Irak et en Afghanistan, est devenu avec les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie et la France, l’un des grands marchands d’armes sur la planète.
On voit le désastre que cela donne en Afrique et dans tous ces pays dits hypocritement en voie de développement : des massacres, des génocides, la mort de millions de personnes, le déplacement de millions d’autres, une pauvreté endémique et les sales maladies qui vont avec.
Il est difficile dans des médias qui, pour la plupart, appartiennent à des intérêts étrangers, de s’y faire entendre vraiment. Même quand Le Devoir promeut le bilinguisme pour tous, on ne peut que désespérer de notre avenir collectif.
Si nous-mêmes comme peuple nous tombons à pieds joints dans l’anglomanie, comment voulez-vous que le français puisse avoir une force d’attraction suffisante pour que les immigrants s’y adonnent véritablement ?
Tout cela pour vous dire que mon désarroi est grand aujourd’hui. Ce Québec français, pacifiste, soucieux des minorités souffrantes d’ailleurs, on est en train de nous l’enlever. Moi, je me sens orphelin ces jours-ci. Doublement orphelin. Orphelin sur ma terre natale, Trois-Pistoles, qui a refusé que je lui redonne ce qu’elle m’avait prêté à ma naissance : ce sens de la culture et son inscription dans la modernité.
Orphelin aussi parce qu’à Montréal on dit de moi que je représente le Québec ancien dont on ne veut plus, que je suis une manière d’ayatollah, sinon de taliban arriéré dont on souhaite la mort, comme l’ont écrit deux lecteurs du journal Le Devoir qui a publié la chose sans sourciller. Imaginez si on avait écrit cela d’un membre de la communauté juive ou d’un musulman ! Le Devoir aurait-il été aussi néolibéral?
Il faut que je trouve des réponses au désarroi qui m’habite. C’est pourquoi je vais passer les deux prochains mois à y réfléchir.
Moi qui suis pacifiste, je voudrais que le Québec devienne un pays et que cela lui arrive sans violence. Mais maintenant que nous n’avons plus de parti indépendantiste, que faire ? Nous laisser assimiler en contribuant nous-mêmes à cette assimilation ?
Mon désarroi est grand, je vous l’ai dit. Et c’est ce désarroi que j’ai d’abord exprimé dans La grande tribu, c’est la faute à Papineau : peut-on se libérer du joug des répressions, celles des autres comme celles qu’on cultive en nous au point d’en être devenus schizophrènes sans vouloir l’admettre ?
Et que refuse-t-on de soi quand on ne veut pas guérir de sa schizophrénie ? La liberté, bien sûr, ce pour quoi se battent les personnages de La grande tribu, c’est la faute à Papineau.
Mais sans doute ai-je écrit ma grotesquerie trop tard. La partie est peut-être toute jouée déjà. Si cela devait être le cas, j’ai conscience que j’aurai passé ma vie à écrire pour rien que j’aime tous les pays qu’il y a dans mon pays, que j’aime la langue française-québécoise sur laquelle je n’ai pas cessé de travailler pour qu’elle dise même l’au-delà de ce que nous sommes.
Si je me suis trompé, j’aimerais mieux que mon œuvre disparaisse à jamais et dès maintenant. Je l’ai écrite parce que, en définitive, je voulais chanter la vie québécoise possible ; et la vie ne signifie plus rien si ce n’est pas la liberté qui la fonde.
Après les deux mois de réflexion que je m’accorde, s’il fallait que j’en vienne définitivement à la conclusion que je me suis véritablement trompé, je ferai ce que symboliquement je vais faire aujourd’hui : brûler dans mon poêle à bois non seulement La grande tribu, c’est la faute à Papineau, mais tous les ouvrages que j’ai écrits.
Je ne veux pas me survivre juste pour moi-même. Je sais trop que si le génie existe, il n’a rien à voir avec l’individu, mais tout à voir avec la société qui le porte et qu’il porte.
Sans véritable patrie, l’individu n’est qu’une statistique, et les statistiques ne sont que les débris que laisse derrière elle l’Histoire des autres. Ça ne m’intéresse pas, mais pas pantoute, de devenir un débris de l’Histoire des autres.
Voilà.
Trois-Pistoles, ce mardi 26 février 2008
Ce n’est plus la faute à Papineau
Il faut que je trouve des réponses au désarroi qui m’habite. C’est pourquoi je vais passer les deux prochains mois à y réfléchir.
VLB - coup de pied dans la fourmilière

Victor-Lévy Beaulieu84 articles
Victor-Lévy Beaulieu participe de la démesure des personnages qui habitent son œuvre. Autant de livres que d'années vécues, souligne-t-il à la blague, comme pour atténuer l'espèce de vertige que l'on peut éprouver devant une œuvre aussi imposante et singul...
Cliquer ici pour plus d'information
Victor-Lévy Beaulieu participe de la démesure des personnages qui habitent son œuvre. Autant de livres que d'années vécues, souligne-t-il à la blague, comme pour atténuer l'espèce de vertige que l'on peut éprouver devant une œuvre aussi imposante et singulière. Une bonne trentaine de romans, une douzaine d'essais et autant de pièces de théâtre ; des adaptations pour la télévision










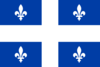







Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé