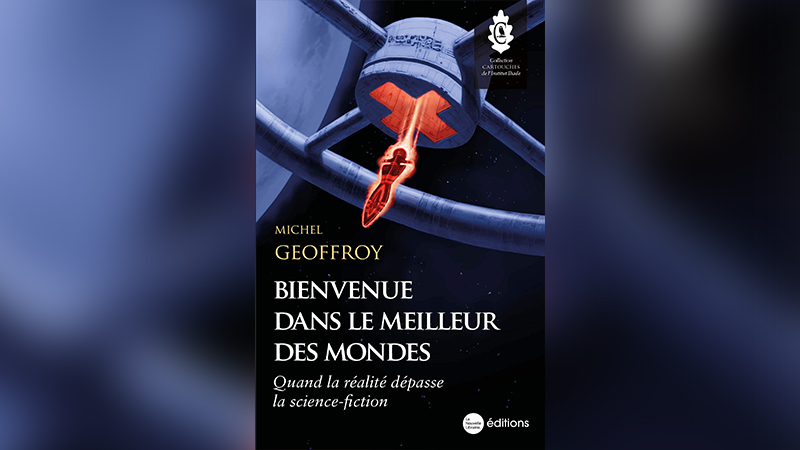Par Johan Hardoy ♦ Michel Geoffroy est non seulement un contributeur prolifique de Polémia mais également un auteur de livres de synthèse et de réflexion. Le dernier en date, Bienvenue dans le meilleur des mondes – Quand la réalité dépasse la science-fiction (Éditions La Nouvelle Librairie, 87 pages, 9 euros), évoque avec une joyeuse érudition les fictions littéraires et cinématographiques qui ont fleuri depuis le XIXe siècle, principalement dans le monde anglo-saxon. Il rappelle aussi que la France compte un précurseur fameux au XVIIe siècle avec Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, dont les nouvelles relataient des voyages sur la Lune et le Soleil.
Si certaines œuvres vantent un futur technologique radieux, d’autres anticipent un avenir dystopique qui se révèle finalement plus proche des réalités présentes. De fait, l’optimisme positiviste a perdu en crédibilité en Occident.
Des archétypes revisités
Michel Geoffroy définit la science-fiction comme « un genre spécifique qui prétend décrire notre futur en extrapolant les données de la science ou de la technologie du moment ».
Bien qu’inséparables de l’esprit scientifique, ces romanciers ne sont pourtant que très rarement des spécialistes reconnus et leurs récits visent davantage à actualiser des grands archétypes tels que le mythe de Prométhée, les voyages dans l’espace, l’Atlantide, les paradoxes temporels, etc.
Écrit au XIIe siècle, bien avant les découvertes de la physique quantique, le Lai de Guingamor narre la rencontre d’un chevalier avec une fée, puis son retour dans le monde où il constate que celle-ci a davantage vieilli que lui.
L’idéologie progressiste relève-t-elle de la science-fiction ?
La question mérite d’être posée tant « l’utopie progressiste », conséquence de la révolution des Lumières au XVIIIe siècle, correspond à un récit mêlant fiction et scientisme. Une anthropologie imaginaire – le « bon sauvage », l’homme naturel isolé de ses semblables et envisagé comme une cire vierge et un simple produit de sa société – se conjugue ici avec une perspective reposant sur les connaissances scientifiques du XVIIIe siècle qui appréhendent le monde comme une mécanique.
Le discours progressiste propose ainsi un sens de l’histoire tout en dévalorisant un passé volontiers considéré comme obscurantiste.
De son côté, la science-fiction s’inspire à la fois du progressisme et du scientisme. Les sociétés imaginaires de l’avenir sont d’ailleurs très souvent des mondes sans religion, à moins qu’y règne le plus grand syncrétisme.
Certains auteurs, de tendance « utopiste », défendent un « credo futuriste et progressiste » riche de promesses d’avenir radieux : gouvernement mondial, exploitation rationnelle de la planète, conquête spatiale, etc.
Dans cette veine, la science-fiction soviétique promettait pour demain l’abondance et la société sans classes. Nous autres, la dystopie d’Ievgueni Zamiatine parue en 1920 qui aurait influencé George Orwell, sera très vite interdite en URSS.
Un Nouveau Monde friand d’avenir
Au XXe siècle, la fiction scientifique et le progressisme rencontrent l’américanisme. La science-fiction devient alors de plus en plus anglo-saxonne dans son inspiration et ses auteurs, d’autant qu’elle intéresse le cinéma. Comme dans les westerns, les films reprennent des thèmes classiques comme celui du redresseur de torts.
Les États-Unis utilisent alors massivement ce genre pour promouvoir leur soft power. Après-guerre, l’Europe est inondée de comics valorisant les valeurs américaines par le biais des exploits de super-héros. Dans le même temps se développe le thème des extra-terrestres qui menacent de détruire le « monde libre », à l’instar des communistes qui combattent l’American way of life.
La psychose de l’apocalypse nucléaire est largement exploitée, de même que la variante de la guerre bactériologique avec les nombreux remakes de Je suis une légende, le roman de Richard Matheson.
Depuis la chute de l’URSS, la science-fiction anglo-saxonne s’est mise à l’heure du mondialisme, sous la direction américaine évidemment !
Ray Bradbury détonnait quelque peu avec ses Chroniques martiennes parues en 1950, qui peuvent se lire comme une mise en garde contre les migrations massives. Ses nouvelles relatent, en effet, ce que l’on nommerait aujourd’hui le « grand remplacement » de la population martienne par des colons en provenance de la Terre.
Quand la dystopie anticipe la réalité
De nombreux auteurs se sont démarqués de l’optimisme progressiste en envisageant un avenir déshumanisé par la technologie, la décadence de l’espèce humaine et l’avènement de tyrannies d’un nouveau type.
Les plus célèbres sont incontestablement Herbert George Wells (La Guerre des Mondes, L’Île du docteur Moreau, L’Homme invisible, La Machine à explorer le temps), George Orwell (1984) et Aldous Huxley (Le Meilleur des Mondes), sans oublier Jules Verne dans certains de ses romans (Les Cinq Cents Millions de la Bégum, L’Île à hélice, Paris au XXe siècle).
Comme l’écrit Michel Geoffroy, « Chacun à leur manière, ces auteurs mettent en garde contre l’arraisonnement du monde par la technoscience qui ouvre la voie à l’âge des Titans, de la démesure, de l’hybris, qui caractérise la modernité occidentale. » « Cette science-fiction revisite bien sûr le thème de l’apprenti sorcier : le héros du conte de Goethe qui invoque des puissances – la science et la technique – qu’ensuite il ne parvient plus à diriger. Ou celui du Golem de Prague ou de Frankenstein, la créature qui échappe à son créateur. »
En 1958, Huxley publie son Retour au Meilleur des Mondes dans lequel il affirme que le monde moderne se dirige tout droit vers ce qu’il imaginait un quart de siècle plus tôt, à savoir un conditionnement et une soumission des foules obtenus par l’addiction à des plaisirs et au « soma », la « drogue du bonheur ».
Créée dans les années 1960, la série télévisée britannique Le Prisonnier met en scène un remarquable exemple de « soft tyrannie » appuyé sur un système de surveillance de tous les instants dont l’agent des services secrets démissionnaire, appelé « n° 6 », cherche désespérément l’issue.
En 1975, le film Rollerball décrit un monde soumis aux grandes corporations où l’énergie de la population est canalisée par l’échangisme sexuel et la violence sportive vécue par procuration.
Matrix, sorti en 1999, décrit un futur où les machines ont pris le pouvoir sur les hommes, considérés comme des « ressources humaines ». Une « pilule bleue » permet de rester dans l’ignorance du fonctionnement du monde artificiel de la matrice, alors qu’une « pilule rouge » permet de connaître la vérité dérangeante.
La science-fiction dystopique annonce l’avènement d’un ordre totalitaire dont la dimension orwellienne nous semble désormais familière : propagande de masse via l’omniprésence des écrans, « police de la pensée », réécriture du passé, « minutes de la haine » programmées, utilisation de la peur comme moyen de sidération, novlangue… Le tout pour le plus grand bénéfice d’une oligarchie s’écartant toujours davantage de la common decency chère à l’auteur anglais. Cependant, là où Orwell évoquait la toute-puissance d’un État et d’un parti unique, notre présent, en Occident, est plutôt caractérisé par leur affaiblissement au profit d’acteurs privés comme les banques, les multinationales, les groupes de pression, les médias, les ONG…
Cette nouvelle tyrannie peut sans complexe brandir l’étendard de la liberté, comme l’ont découvert avec effroi les regards aiguisés de dissidents soviétiques accueillis en Occident durant la Guerre froide, et même devenir subitement violente si elle se sent menacée, comme l’a montré récemment la répression en France du mouvement des Gilets jaunes.
Une dissidence individuelle
Les films et les romans qui relatent un totalitarisme futur mettent souvent en scène l’image positive du dissident et du rebelle en lutte solitaire contre un système oppressif.
Les réactions dépeintes sont le fait d’individus et non de groupes organisés et soudés par une pensée alternative. L’ère des grands récits susceptibles d’enthousiasmer les masses semble révolue pour ces auteurs.
De façon apparemment paradoxale, Michel Geoffroy rapproche cette volonté de résistance de la perspective élitiste défendue par le penseur traditionaliste italien Julius Evola (Les Hommes au milieu des ruines, Chevaucher le Tigre…). Difficile, en effet, de trouver un auteur plus hostile à toute forme d’idéologie progressiste que ce réactionnaire assumé !
Que les candidats à la dissidence se hâtent donc de se doter d’une colonne vertébrale doctrinale en lisant des livres coupables de défendre une croyance ou un doute contraires aux intérêts de l’oligarchie au pouvoir (un « crime de pensée » au sens orwellien), avant que celle-ci n’ordonne de les brûler comme dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury !
Johan Hardoy
20/06/2023