Il y a cent ans, le 11 mars 1913, naissait la Ligue de défense des droits du français. Cette ligue fondera, quatre ans plus tard, la revue L’Action française – qui deviendra par la suite L’Action nationale. Cette organisation donnera une impulsion décisive à un mouvement qui traversera tout le siècle et qui fera de la défense et de la promotion du français un puissant levier de construction de la conscience nationale et de renforcement de la culture canadienne-française.
La Ligue va se construire patiemment sur le constat, de plus en plus tragiquement affirmé, que le Canada est une terre hostile pour le français. La nouveauté de sa contribution, par ailleurs, ne réside pas tant dans le constat lui-même, mille fois réalisé et illustré par la mise au ban du français dans l’Ouest, par l’odieux règlement XVII ontarien et par l’intolérance orangiste dans les Maritimes, mais bien par la décision d’y réagir par la mise en place d’une riposte organisée, portée par la société civile. La Ligue va sortir de la logique strictement défensive et s’efforcer de mobiliser non seulement pour la revendication des droits du français, mais aussi pour la francisation de notre société assiégée. Cette orientation l’amènera à produire des lexiques pour contrer l’anglicisation des milieux de travail, pour franciser la langue du commerce, etc. Tout cela n’est pas réductible à ce que certains ont caricaturé en ramenant cet effort aux seules dimensions des campagnes du bon parler français. La Ligue se proposait d’unir l’action dirigée sur la société québécoise et celle visant l’État canadien dans une perspective intégrée. C’est ainsi que la production de matériel de francisation aura également servi à ouvrir les horizons et à accentuer les débats sur le statut du français aussi bien dans l’État que dans la vie collective. À plus d’un égard, le programme de la Ligue des droits du français et ses principales réalisations préfigurent les innovations qui conduiront à la loi 101 et à la création des institutions comme l’Office de la langue française. Il témoigne également de l’extraordinaire détermination qu’il aura fallu pour que le Québec français relève la tête un tant soit peu.
C’est avec la création de L’Action française, organe de diffusion et de réflexion de la Ligue, que la question de la langue va trouver une formulation qui lui donnera son horizon le plus inspirant. En faisant le procès et le bilan des cinquante ans de ce qu’on appelle alors la Confédération canadienne, L’Action française va ranimer le projet indépendantiste en l’établissant clairement comme l’ultime aboutissement et la condition essentielle de l’épanouissement de notre peuple dans sa langue et sa culture. Le cheminement sera long et laborieux, inutile de le dire en ce printemps morose de 2013. Le gouvernement canadien reste la première cible dans la mesure où l’ambition canadienne-française reste encore celle de se déployer dans ce pays que les ancêtres ont ouvert. Il faudra du temps avant que la perspective se centre sur le Québec d’abord. Et cela ne se fera qu’avec le constat de plus en plus difficile à nier que le sort des minorités hors Québec est plombé et qu’il faut l’aborder autrement, sans le lier avec celui qu’il est possible de définir pour le Québec, le seul foyer national. Pendant cette période, l’assimilation aura fait d’énormes ravages et réduit le poids relatif du français à un niveau qui ne cesse aujourd’hui encore de décliner.
La revue fondée par la Ligue des droits du français sera à la fois le théâtre et le foyer de résistance à l’assimilation et à la minorisation définitive, irréversible. En quatre-vingt-quinze ans, elle va publier tout près de mille articles sur notre lancinant problème linguistique existentiel ! Des textes de dénonciation, des pamphlets rageurs, des analyses méticuleuses, des constats inquiets, des appels consternés, sur tous les tons, dans tous les registres, le combat pour le français aura marqué le devenir de la revue, le destin de notre peuple. Il aura fallu soixante ans de revendication pour qu’apparaisse un mot de français sur les timbres, soixante-neuf ans pour que les billets de banque soient bilingues et quatre-vingt-quinze ans pour qu’Ottawa finisse par libeller ses chèques en français ! Une énergie folle a été engloutie pour n’obtenir que des concessions dérisoires dans lesquelles un trop grand nombre des nôtres essayaient de voir des victoires rassurantes pour l’avenir du français au Canada.
Et nous voici, des milliers de pages plus tard, à consacrer un autre dossier à la défense de notre langue. Après la loi 101, après son charcutage systématique et la guerre linguistique menée sans relâche, un autre dossier pour se mobiliser, certes. Mais surtout pour constater que tout est toujours à recommencer. Jamais notre situation ne sera confortable, toujours nous resterons ultra-minoritaires sur le continent. C’est entendu. Mais ce qu’il nous faut désormais faire passer de toute urgence dans la conscience nationale, c’est, que jamais ne seront acceptés dans le Canada le Québec français et la construction d’une société intégralement française. Aux pressions continentales et aux lois impitoyables de la démographie, s’ajoutent les certitudes idéologiques et les idéaux du multiculturalisme. La domination de l’anglais est consubstantielle aux institutions et à l’imaginaire politique du Canada.
Domination linguistique et culturelle et marginalisation politique du Québec vont de pair. Et la guerre psychologique menée, depuis 1995 en particulier, avec un appareil de propagande immense qui ne vise qu’à briser la cohésion nationale, en érodant le statut et les institutions du Québec français. Ce travail s’est poursuivi sur tous les fronts en jouant de tous les subterfuges juridiques d’un ordre constitutionnel conçu fondamentalement pour empêcher la construction d’une société intégralement française. Il se continue de plus belle et c’est lui, et lui seul, qui nous a conduits à recommencer le débat sur la restauration de la loi 101 par un projet de loi 14 dont le sort est déjà réglé. Ou bien il ne sera qu’une bluette aménagée pour satisfaire aux compromis déshonorants imposés par un Parti libéral au service des blocs ethniques anglicisés qui le contrôle et par une Coalition avenir Québec qui souscrit ouvertement à la logique de folklorisation en s’acharnant à minimiser l’importance du français dans notre développement. Ou bien, il a, par un miracle impossible à prévoir, un peu de mordant et les assauts des lobbys financés pour le combattre permettront aux tribunaux fédéraux de l’édenter en moins de temps qu’il n’en faut pour écrire le mot sournois.
Les textes qu’on lira ici et le dossier qu’ils étoffent viendront montrer les limites d’une position velléitaire comme celle qui prévaut dans l’actuel projet de loi 14. Le texte du SPQ Libre, en particulier, montre bien que ce projet n’obtient pas la note de passage du compromis temporaire. Même en sachant que le projet de loi ne durera pas, sa formulation actuelle le laisse en deçà de ce qu’une attitude déterminée à saisir la conscience nationale exigerait du gouvernement. On aurait été en droit de s’attendre à ce que le projet fournisse la matière à un débat rigoureux sur la langue de travail, sur la fréquentation obligatoire du cégep français, sur le statut des villes bilingues. Le rendez-vous est d’ores et déjà raté.
Et s’il l’est, c’est essentiellement que le projet reste dans le prolongement d’une logique qui a creusé les plus importantes failles dans les efforts de francisation des quarante dernières années. Il renonce à reconfigurer les institutions anglaises pour les intégrer dans la logique de fonctionnement des institutions nationales. Il maintient la logique du développement séparé qui laisse les institutions de santé, d’éducation et de services publics dans la pratique d’un bilinguisme autorisé qui n’a fait que s’étendre et éroder les maigres gains réalisés par la loi 101. L’étude de l’Institut de recherche en économie contemporaine, réalisée pour le compte de l’Institut de recherche sur le français en Amérique, l’a établi de manière accablante : le surfinancement des institutions anglaises draine au moins deux milliards de fonds publics et entretient cinquante mille emplois qui devraient se trouver dans le réseau français, des emplois qui ne servent qu’à imposer à une majorité de travailleurs francophones et allophones de travailler en anglais pour offrir en anglais des services à une population majoritairement française.
Le texte extrêmement fouillé que nous livre Pierre Serré vient ici donner un écho tonitruant à cette première étude. Il en ressort brutalement que le débat sur la minorité anglo-québécoise est en porte-à-faux avec la réalité démographique telle qu’on peut rigoureusement la décrire. Il est de part en part traversé par une puissante force idéologique qui nourrit chez les uns un refus farouche du Québec français et chez les autres un aveuglement volontaire sidérant. Il en ressort qu’il faut sortir des paramètres dans lesquels la guerre à la loi 101 nous a enfermés. Par-delà, les aléas juridiques que nous imposera toujours un régime hostile à l’unilinguisme français, c’est la réalité des insuffisances de l’approche du gouvernement du Québec qu’il faut débusquer. Il faut reconstruire l’édifice conceptuel et penser la reconfiguration des institutions en prenant appui sur ce qu’est devenue la réalité démographique de la communauté anglo-québécoise. Plus que jamais, elle est et elle doit être considérée comme un avant-poste de la majorité canadian dont la composition n’a rien à voir avec celle d’une quelconque minorité ethnique nationale.
À la lumière des analyses de Serré il apparaît que la configuration institutionnelle qui formate l’offre de services anglais est essentiellement l’expression d’un déficit d’aménagement linguistique qui interpelle d’abord et avant tout le gouvernement du Québec. Cette configuration ne s’explique que par la démission, le déni ou la crainte d’affronter un puissant lobby, celui de l’Anglo Compact et ne s’appuie sur aucun fondement juridique. Ce déficit a transformé ce qu’étaient historiquement ces institutions que la démographie de la minorité anglaise ne peut plus porter, en structures de transit pour des anglicisés en provenance du Canada, de pays étrangers ou du Québec même. Ces structures permettent aux migrants de vivre en Québec sans avoir à trop composer avec la vie nationale française et ne se maintiennent que par le recours systématique non seulement aux fonds publics, mais encore et surtout à la main d’oeuvre francophone et allophone qu’elles contraignent à travailler en anglais et transforment de facto en agents de bilinguisation. Il faut donc voir les choses comme elles sont devenues : le gouvernement du Québec finance un dangereux travail de sape du français. C’est un constat très dur et éminemment difficile à faire passer dans la conscience nationale – et sans doute encore plus difficile à faire pénétrer dans la pensée molle qui caractérise l’ensemble de la classe politique. Et c’est là tout le chantier de travail que le présent dossier vient d’ouvrir.
La question du statut du français est une affaire de domination politique et culturelle qui ne renvoie pas seulement aux rapports et structures de pouvoir que le Canada exerce sur nous. C’est aussi et plus clairement que jamais une affaire interne, une affaire de développement culturel dévoyé par l’intériorisation des figures et de la logique de minorisation. Le rapport des langues n’est pas seulement une question de hiérarchisation formelle, c’est aussi et surtout de l’intériorisation d’un procès pour insuffisance que la culture minorisée s’instruit elle-même. C’est ce procès sourd qui explique les lacunes de l’aménagement linguistique, qui nourrit un déficit qui ne tient qu’au refus de se poser et de s’imposer. Les chantres du bilinguisme ne font pas seulement que de l’arithmétique de névrosés en s’imaginant que deux langues valent mieux qu’une et qu’on peut les additionner sur le mode du cannibale qui dévore le cœur de l’Autre pour s’en approprier la force, ils travaillent à définir la culture sur le mode du manque. Ils déplorent la vie de ces Québécois qui ne parlent « que » leur langue sans trop s’inquiéter de celle de l’immense majorité des êtres humains qui se pensent dans leur langue maternelle et y vivent sans s’en faire un procès.
Il faut revenir sur ces formes malsaines qui minent le rapport à la langue et, du coup à la culture. Le Québec de la loi 14 est un Québec qui campe sur les bords d’une régression culturelle majeure. Le texte de Paul Daoust nous montre bien que les fondements de cette régression sont essentiellement d’ordre fantasmatique. Il n’y a aucun peuple intégralement bilingue et tout ce que nous savons de la linguistique contemporaine nous enseigne que la problématique des langues telles qu’elle est construite dans le débat sur l’enseignement de l’anglais, sur la cohabitation égalitaire et la neutralité pseudo-inoffensive des signes institutionnels dans l’espace public ne repose en définitive que sur des rationalisations visant à justifier, soit la démission devant les faits, soit le consentement à un ordre posé comme intrinsèquement supérieur. Et c’est précisément parce que ces rationalisations relèvent d’abord et avant tout du fantasme qu’elles sont si tenaces et si puissantes.
En dépit des immenses efforts déployés ces dernières décennies, les dynamiques culturelles engendrées par la logique de domination des langues ont sapé même les choix partiels d’aménagement linguistique voulus par la loi 101 et transformé en coquille évidée le consensus original qui lui a donné naissance. Le fantasme du bilinguisme n’en finit plus de nourrir toutes sortes de figures spectrales – peur de vivre et peur de se fermer au monde finissent par s’y équivaloir – qui ont déporté le développement culturel dans un étrange no man’s land. Autant la culture québécoise a-t-elle su se montrer dynamique et inventive, autant elle est restée étrangère à un segment grossissant de la population québécoise, au point qu’en tant que culture nationale elle reste exotique pour ceux-là mêmes qui devraient y trouver le lieu et les matériaux de leur participation à la vie publique. L’apartheid furtif est devenu une réalité majeure dans la métropole et une caractéristique silencieuse de la culture qui se fait. Et ses effets les plus pernicieux se manifestent sous la forme des pratiques culturelles de transfert qui, sous couvert d’aller à la rencontre de l’Autre, ne serve qu’à s’y dissoudre. Il suffit pour s’en convaincre de tendre l’oreille aux chantres de l’esprit d’ouverture du Mile-End qui font les belles heures d’une certaine engeance branchée qui sévit dans les médias. Le texte de Daoust démonte efficacement les raccourcis intellectuels qui nourrissent ce genre de mirage et leur confère une efficacité certaine.
C’est sans contredit le texte de Gaston Miron « Le bilingue de naissance » qui a poussé le plus loin la déconstruction de ces pratiques compensatoires et fantasmatiques qui font du bilinguisme un horizon culturel dans la culture québécoise. Il était important de le reproduire ici, tant son actualité est brûlante et profonde son analyse. Si ce texte est toujours pertinent, c’est que Miron a vu juste. Pour conforter le statut du français il faut un immense effort dans la culture, un effort de construction pour se poser dans un rapport à l’Autre qui ne soit pas structuré sur le mode de la carence, de la lacune. Cet effort c’est celui de poser le Québec au centre de son monde. C’est celui de faire de sa culture sa Norme et sa Référence pour entrer en relation avec lui-même et avec le monde. Pour que cela se produise, il faut que les institutions trouvent dans cette culture non seulement la matière de leur développement, mais encore et surtout le socle des modèles qu’ils servent à diffuser et à reproduire.
Force est de reconnaître que cela ne s’est pas produit, puisque de nombreux Québécois – et pas nécessairement seulement dans les couches anglaises et anglicisées – grandissent sans repères culturels fondamentaux. Le multiculturalisme dominant a largement contribué à rendre accessoire la référence québécoise, à la banaliser, à la transformer en matériau pour la représentation folklorique de nous-mêmes. Et les représentations fantasmatiques du bilingue qui la relaient servent désormais à nous priver de notre nom même tant il est devenu banal de désigner la culture québécoise dans les circonvolutions du neutre générique où elle n’est plus désignée que par rapport à l’anglais dans l’expression culture francophone. Son usage ne sacrifie pas seulement à un barbarisme créé par les catégories tordues du Canada où l’on peut être « servi dans la langue de son choix », il participe d’un consentement à se laisser désincarner, à se laisser dissoudre pour mieux flotter dans l’espace éthéré du non-être. Nous ne sommes pas des francophones. Nous sommes le peuple du Québec et nous parlons français, pas le « frincophône ».
Il faut le répéter encore et toujours : pour assurer l’épanouissement du français, il faut l’indépendance politique. Mais il faut aussi et surtout une culture forte capable de conquérir son espace et d’assurer sa pérennité en se produisant comme le véhicule et le milieu de la plénitude de sa vie ou, si l’on veut, comme le lieu de construction de l’identité, aussi bien personnelle que collective. Sans dynamisme culturel soucieux de transmission, le combat pour la langue est un combat perdu. C’est pourquoi il faut au plus tôt reconfigurer les institutions qui servent à élargir les marges où l’anglicisation va de pair avec une ignorance de la culture qui ne produit, à terme, que le refus de la langue et la condescendance pour ceux qui la parlent. Le mot de Miron résonne ici d’une implacable lucidité : « Quand un peuple peut choisir d’être autre, c’est qu’il se nie en tant que peuple, et c’est que quelqu’un d’autre est sur place et à sa place ».
On ne fera pas le Québec français sans faire l’indépendance.
On ne fera pas le Québec français sans faire l'indépendance
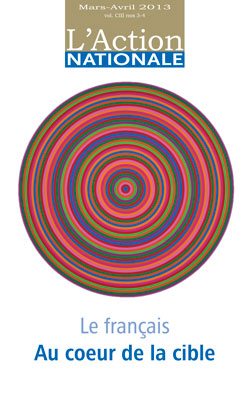
Ce qu'il nous faut comprendre.

Robert Laplante173 articles
Robert Laplante est un sociologue et un journaliste québécois. Il est le directeur de la revue nationaliste [L'Action nationale->http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Action_nationale]. Il dirige aussi l'Institut de recherche en économie contemporaine.
Patri...
Cliquer ici pour plus d'information
Robert Laplante est un sociologue et un journaliste québécois. Il est le directeur de la revue nationaliste [L'Action nationale->http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Action_nationale]. Il dirige aussi l'Institut de recherche en économie contemporaine.
Patriote de l'année 2008 - [Allocution de Robert Laplante->http://www.action-nationale.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=752&Itemid=182]

























Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé