Le 1er mai 1997, Fernand Dumont nous quittait. Qui « nous » ? Question intempestive ces temps-ci au Québec, à moins de célébrer l’homme mondialisé, en élargissant libéralement la définition du « nous » à la dimension de l’humanité tout entière, aux dépens de ce qui en constitue la spécificité irréductible. Ce que Dumont lui-même appréhendait. Son « nous » n’avait pourtant rien d’exclusif. « Dans les solidarités nationales comptent le choix des personnes, l’acceptation ou l’élection d’une identité », souligne-t-il dans Raisons communes.
Du reste, il suffit de feuilleter ses grands ouvrages théoriques pour se convaincre de son ouverture aux autres « nous ». En effet, on ne trouvera aucune allusion au Québec dans ces livres-là, destinés à un lectorat universel. Encore faut-il ne pas se laisser abuser par le mot « universel », car c’est toujours à partir du souvenir obsédant de ce qu’il appelle son « émigration » que Dumont pense l’homme et la culture en un sens universel. « Penser, c’est penser pour soi, ne serait-ce que pour penser le hors de soi. Mais le pour-soi n’est pas une conquête de l’instant ; il s’appréhende grâce à une mémoire des origines. »
De cette mémoire des origines, Dumont a fait l’assise d’une méthode où l’universel, au lieu d’être plaqué abstraitement sur le particulier, s’en nourrit. N’est-ce pas d’ailleurs le propre de toutes les pensées authentiquement universelles de partir du particulier pour accéder à l’universel ? À un universel concret, transposable dans une autre culture, traduisible dans une autre langue, comme le sont, par exemple, les pièces de Michel Tremblay.
Se remémorant, dans Récit d’une émigration, les pensées qui l’habitaient durant ses années d’études au Petit Séminaire de Québec à la fin des années quarante, Dumont écrit : « J’entrevoyais comment il me faudrait assumer […] le déchirement qui avait accompagné mon difficile passage de la culture populaire à la culture savante. Prendre la culture comme problème, n’était-ce pas penser l’exil ? La nostalgie qui me restait de la culture populaire ne m’apparaissait plus comme une vaine sensiblerie, mais comme une opportune mise à distance, une précieuse naïveté devant la culture savante qui en constituait la contrepartie. Au lieu de liquider le malaise qui m’avait tourmenté jusqu’alors, j’en ferais le problème central de ma recherche : ce genre de problème qui, parce qu’il tient à son existence même, ne sera jamais résolu, présent à tous les autres auxquels on voue sa vigilance et ses écritures. »
Nation francophone
N’est-ce pas une semblable « émigration » qu’a connue la nation francophone du Québec à travers la Révolution tranquille ? J’emprunte à Dumont lui-même l’expression « nation francophone ». D’aucuns se souviendront de la polémique qu’il avait déclenchée dans les milieux intellectuels souverainistes en osant formuler la question suivante dans Raisons communes : « Si nos concitoyens anglais du Québec ne se sentent pas appartenir à notre nation, si beaucoup d’allophones y répugnent, si les autochtones s’y refusent, puis-je les y englober par la magie du vocabulaire ? L’histoire a façonné une nation française en Amérique ; par quelle décision subite pense-t-on la changer en une nation québécoise ? »
Qu’est-ce qu’un Québécois ? Un francophone du Québec ou l’habitant du territoire du Québec ? Force est d’admettre que nous ne le savons plus très bien. C’est à cette ambiguïté que Dumont s’est attaqué. Convaincu que le projet de souveraineté concernait par-dessus tout le sort de la nation francophone, il ne croyait pas pour autant qu’un Québec souverain dût s’engager dans la fondation d’un État national. Il envisageait plutôt la construction d’une véritable communauté politique à laquelle tous participent, francophones, anglophones, allophones et autochtones. Reste que, dans le contexte spécifique du Québec, une communauté politique ne peut exister, selon lui, sans une langue et une culture de convergence. Or, insistait-il, « si culture de convergence il y a un jour, ce ne sera pas un composé de laboratoire ou de convention ; ce sera la culture française. Sinon, la question d’une communauté politique québécoise, souveraine ou provinciale, deviendra sans objet. C’est dire que nos efforts principaux doivent porter sur la qualité de la langue et la vigueur du système d’éducation ».
La communauté politique québécoise
Qu’en est-il, vingt ans après la mort de Fernand Dumont, de cette communauté politique québécoise ? Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est loin d’être acquise. En même temps que le poids démographique des francophones au Québec ne cesse de diminuer, le visage français de Montréal prend l’allure d’un masque derrière lequel progresse l’anglicisation ; les immigrants, malgré la loi 101 (dont Dumont fut l’un des rédacteurs), continuent à se tourner majoritairement vers l’anglais ; gavé de discours lénifiants, notre système d’éducation s’embourbe sous les réformes de programme et les improvisations pédagogiques de toutes sortes. Quant à la souveraineté, qui eût peut-être pu redonner un nouveau souffle à notre « miraculeuse survivance », n’en parlons pas.
> Lire la suite de l'article sur Le Devoir
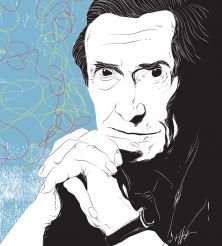





























Laissez un commentaire Votre adresse courriel ne sera pas publiée.
Veuillez vous connecter afin de laisser un commentaire.
Aucun commentaire trouvé