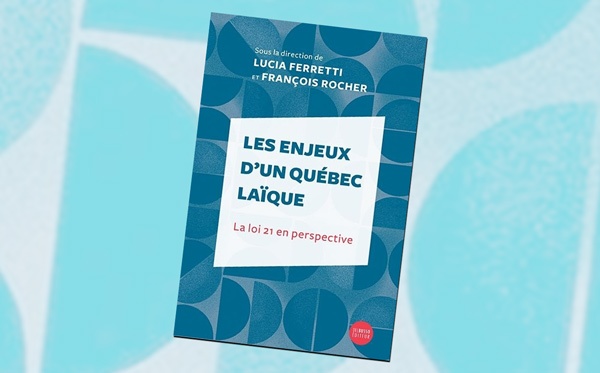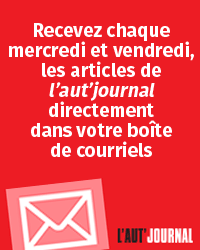Longueur de l’article : 3500 mots.
Autrefois, nous nous définissions d’abord par notre foi et aussi par notre langue. Puis, nous avons rejeté l’emprise excessive d’une religion sur nos vies. Il était entendu que nous étions presque tous de race blanche, mais que nous étions malgré cela dominés. Pendant quelques décennies, dans la deuxième moitié du vingtième siècle, nous nous sommes surtout définis par la langue dont nous avons hérité. Nous avons poursuivi notre prise de conscience collective. Aujourd’hui, nous nous définissons par la langue et la laïcité, par notre profond attachement à la démocratie et à la liberté, et nous voyons que nous sommes de toutes les couleurs et de toutes les origines. La laïcité est au cœur de qui nous sommes. La laïcité est au cœur de notre nation. Tenter de nous priver du droit de choisir la laïcité est la nouvelle expression de la domination canadienne sur notre nation.
C’est ce qui ressort à mes yeux de la lecture de l’ouvrage collectif intitulé Les enjeux d’un Québec laïque, publié fin 2020, qui éclaire cet enjeu sous l’angle de l’histoire, de la sociologie, du droit, de la science politique, de la philosophie et de la communication. Cet ouvrage paraît au moment où s’entreprend pour quelques années la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État, la loi 21. Le pouvoir judiciaire fédéral aura à décider de la conformité de cette loi avec une constitution imposée en 1982 par la nation canadienne à la nation québécoise. Ce faisant, il mettra en jeu sa propre légitimité en matière constitutionnelle et sa propre apparence d’impartialité institutionnelle.
Les juges fédéraux auront à décider si cette constitution imposée, qui met l’accent sur la suprématie de Dieu et exige d’être interprétée à la lumière obscure du multiculturalisme, qu’ils ont associé à l’intégrisme religieux, permet la coexistence dans un même État entre le libéralisme québécois, fondé sur une trajectoire historique particulière et un consensus presque inédit, et le libéralisme sectaire du Canada. C’est un conflit profond de valeurs collectives et d’identités nationales qui, au-delà du droit et de la politique, relève davantage de la sociologie et de la philosophie. Les juges fédéraux de la Cour supérieure, de la Cour d’appel et de la Cour suprême du Canada auront à décider s’ils se placent au-dessus de la mêlée et s’ils accommodent et respectent la différence québécoise dans ses choix fondamentaux, ou s’ils aggravent le rapport de domination entre nations qui caractérise le Canada depuis sa fondation. Au-delà de tout l’argumentaire de part et d’autre, c’est essentiellement de cette relation historique dont il s’agit. L’affaire est très sérieuse parce qu’elle ramène à l’avant-plan la crise de légitimité au Québec de l’État canadien et de sa constitution en soulignant leur caractère étranger.
Le libéralisme québécois tente d’aménager de manière rationnelle le rapport entre une société laïque et les différentes religions. Il rejette la confusion canadienne sur la société et la religion. Ce choix démocratique et légitime ne porte pas atteinte aux droits des minorités, qui ne devraient jamais avoir le droit constitutionnel d’imposer leur propagande religieuse dans les institutions publiques qui reflètent l’ensemble de la société.
Les contributions des auteurs de l’ouvrage collectif mentionné, tous issus du milieu universitaire, sont significatives. Elles proviennent de différentes disciplines qui ont toutes un éclairage spécifique à donner. La citoyenne et le citoyen gagneront à en prendre connaissance par une lecture attentive.
François Rocher, politologue, pose bien la question de fond au départ :
« Il est toujours possible d’espérer que les juges manifestent une quelconque sensibilité à l’endroit d’une autre forme de diversité constitutive du Canada qu’est la présence, en son sein, d’une société distincte. Celle-ci partage une lecture différente des principes du libéralisme et de leur inscription dans une configuration particulière des aménagements de la neutralité de l’État qui peut s’éloigner de la doxa multiculturelle qui informe les esprits et le droit au Canada. » (p. 42).
Pour Rocher, l’enjeu consiste à obtenir par la voie judiciaire une reconnaissance substantielle de la société distincte au Québec qu’il n’a pas été possible d’obtenir par la voie politique. Les échos qui nous viennent de l’audition en Cour supérieure nous indiquent qu’il est peu probable que la sensibilité qu’il souhaite nous vienne du juge Blanchard en première instance. Cette audition a plutôt donné lieu, nous dit-on, à du Quebec bashing primaire avec l’accord tacite de ce savant magistrat, qui a clairement renoncé à l’apparence d’impartialité personnelle maintes fois exigée par la Cour suprême.
Lucia Ferretti, historienne, fait voir sa lucidité dans le titre même qu’elle a choisi : Derrière la défense des signes religieux, la volonté de remettre le Québec à sa place. Et elle a le mérite d’être la seule à poser la question ultime :
« Jusqu’à quel point pourrait-il être légitime pour l’État québécois de tenir à une loi votée par l’Assemblée nationale avec le soutien d’une majorité significative de Québécois, même si cette loi, par hypothèse, devait être désavouée par les tribunaux canadiens ? » (p. 47).
On peut ajouter qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle loi ni de n’importe quelle majorité. Il s’agit d’une évolution majeure du droit québécois et d’une des modifications les plus importantes de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne depuis son adoption, qui établit le caractère prépondérant du principe de laïcité. Cette consécration avait été autorisée et presque invitée par la Cour suprême elle-même dans son jugement de 2015 sur la prière au conseil municipal de la Ville de Saguenay. Le déchaînement de la nation canadienne et de Charles Taylor à l’encontre de la loi 21 ne tient même pas compte de la jurisprudence du plus haut tribunal canadien. La majorité québécoise à l’appui de cette loi se situe autour des deux tiers des citoyens et citoyennes. Rejeter un tel consensus aussi intensément marqué serait dangereux pour la stabilité du Canada.
Marc Chevrier, à la fois constitutionnaliste et philosophe politique, fait voir la tension entre la cité civile et la cité religieuse qui a marqué la société des ancêtres de la plupart d’entre nous depuis le Traité de Paris de 1763. On pourrait ajouter que même dans la France de l’Ancien Régime, qui se proclamait la fille aînée de l’Église, le gallicanisme avait préservé une grande autonomie de l’État face au Vatican, et qu’il n’était pas question pour François 1er ou Louis XIV de se soumettre à l’autorité du pape pour ce qui concerne l’entreprise de colonisation.
Chevrier explique avec justesse que le débat sur la laïcité nous ramène aux effets de la Conquête :
« Cependant, cette doctrine, qui semble vivante encore chez certains juristes, ramène au-devant de la scène un élément fondamental que le droit constitutionnel canadien aime bien occulter ou croire derrière lui : la Conquête. Pour cette doctrine, elle constitue au Canada la première des constitutions, car elle précède, fonde et structure toutes celles qui viendront par après. Elle se tient hors du droit, mais l’enveloppe de fond en comble. Dans l’imaginaire juridique canadien, la liberté et l’observance religieuse mobilisent la violence pacificatrice de l’État… » (p. 99).
Cette description de l’effectivité canadienne, condition d’existence de l’État à valeur supra-constitutionnelle, fait découvrir la source de l’hostilité impériale, issue de l’histoire d’Angleterre, à l’encontre de la laïcité québécoise. Cette hostilité originelle de la race britannique, comme on disait en 1867, inscrite dans les gènes de la fédération et dirigée contre les idées politiques d’origine française, s’étendait même jusqu’en 1947 à l’encontre de l’idée d’une citoyenneté canadienne, jugée trop proche du républicanisme et incompatible avec notre statut de sujets d’une Couronne étroitement associée à la confession anglicane, l’équivalent historique d’une religion d’État. Le trône et l’autel ont été aussi étroitement associés dans l’empire britannique qu’ils ne l’ont été ailleurs. Chevrier conclut que cette imbrication a été remplacée au Canada depuis 1982 par une religion civile axée sur une interprétation abusive des droits individuels. Cette religion civile côtoie une monarchie dont l’existence est incompatible avec le principe de laïcité.
Yasmina Chouakri, politologue et féministe, présente le point de vue hautement crédible des femmes québécoises laïques d’origine musulmane. Elles en connaissent beaucoup plus sur le sujet que nos féministes multiculturelles d’obédience canadienne. Son point de vue est juste et cinglant :
« La perception dominante porte bien plus de préjugés et de racisme à l’endroit des musulmanes, qu’on essentialise, que le discours défendant les mêmes droits pour toutes les femmes et dénonçant les oppressions inhérentes à la tradition et à la religion musulmanes » (p. 140).
Ces propos démontrent la faillite intellectuelle et morale du constitutionnalisme canadien relatif au pluralisme religieux de l’État. Cela me rappelle une conversation il y a quelques années avec un chauffeur de taxi d’Ottawa qui, lorsque je lui ai dit que j’étais avocat, m’avait demandé de l’aide parce qu’il avait fui l’intolérance de son pays d’origine au moment où en Ontario on envisageait d’instaurer la Charia pour les musulmans : « Si je meurs demain, ma conjointe devra épouser mon frère intégriste à Toronto ! » Je n’ai rien pu faire en réponse à son appel émouvant, mais je ne l’ai jamais oublié, et c’est en partie en souvenir de lui que je défends la laïcité dans ma société.
Le chapitre juridique du recueil est bien étoffé. Il débute par Me Julie Latour, ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal et fondatrice des Juristes pour la laïcité de l’État, qui présente une réflexion approfondie. Elle rappelle que la liberté de religion est logiquement un aspect de la liberté de conscience plutôt que l’inverse. Pour elle, la laïcité de l’État est la condition première d’une liberté de religion et de conscience non entravée, qui comprend le droit de croire et de ne pas croire. La laïcité a pour objet de défendre la primauté de la liberté de conscience. (J’ajoute que le droit de ne pas croire s’étend aussi jusqu’au droit au blasphème, comme on dit en France à la suite du massacre dans les locaux de Charlie Hebdo en janvier 2015 et du procès qui a suivi récemment).
On doit mettre l’accent sur la liberté de conscience des enfants à l’école publique et des bénéficiaires des services publics plutôt que sur la liberté de manifester des croyances religieuses des enseignants et des fonctionnaires. Elle écrit avec raison que le principe de laïcité est générateur de droits pour ceux et celles qui aspirent à un espace public véritablement neutre, source d’égalité des citoyens. Par conséquent, cet espace public ne peut pas être orienté vers l’intégrisme religieux par des messages vestimentaires réitérés quotidiennement, et doit respecter la liberté de conscience des enfants et de leurs parents. Il ne doit pas soumettre les enfants à l’endoctrinement religieux par le port du voile à l’école publique récemment déconfessionnalisée.
Une mère de famille laïque d’origine tunisienne racontait cette semaine que sa fille de sept ans lui a demandé au retour de l’école pourquoi elle ne portait pas le voile comme son enseignante. La pression pour se conformer au conservatisme religieux provient dans ce cas de l’école publique québécoise financée par les impôts de l’ensemble des citoyens. Voilà où nous conduit l’aberration de la pensée.
Des déclarations peu édifiantes et simplistes provenant du milieu politique n’aident en rien à résoudre ces débats. Nous avons entendu le premier ministre du Canada émettre une simplification outrancière lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait accepter que l’on dise à une femme comment s’habiller. J’imagine sa réaction s’il voyait une fonctionnaire fédérale entrer au travail en costume d’Ève, un soldat avec un chandail sur lequel on pourrait lire qu’il faut envoyer les Juifs au four crématoire comme on l’a vu à Washington le 6 janvier, ou tout simplement un Foque Justin à la Chambre des Communes. La réalité, c’est que, dans une société démocratique soumise aux chartes des droits, on dit très souvent aux hommes et aux femmes comment s’habiller, à commencer par les uniformes des écoles privées que le premier ministre a fréquentées.
Ici, les arguments des opposants à la loi 21 atteignent le grotesque. On nous fait une distinction factice entre la neutralité religieuse de l’État et celle de ses représentants que les sophismes de Trudeau père n’auraient pas reniée. Encore une fois, tout ce qui est exagéré est ridicule.
Julie Latour devient éloquente lorsqu’elle affirme que les droits individuels sont mieux servis par la laïcité :
« En s’ouvrant au pluralisme religieux, ce qui implique l’acceptation de la mouvance spirituelle – telle la possibilité de conversion à une autre foi – et en octroyant droit de cité aux non-croyants, la vision laïque accorde la faculté d’émancipation individuelle. Elle de ce fait est vue par plusieurs comme subversive, car elle dérange les vérités et révélations sur lesquelles se fondent les ordres religieux millénaires des grands monothéismes et leur ambition partagée à la prééminence sociétale. » (à la p. 151).
Julie Latour souligne avec justesse que l’argumentaire juridique des détracteurs de la Loi 21 est porteur d’une inhérente contradiction, car c’est d’abord et avant tout afin de protéger l’intégrité des Chartes des droits qu’ils invoquent que la laïcité de l’État est cruciale.
On s’étonne que des gens sérieux puissent prétendre le contraire. La liberté de religion à la canadienne conforte les monothéismes, que l’on doit renvoyer dos à dos dans leur intransigeance, leur conservatisme social et leur tentatives totalitaires de contrôler les peuples et les esprits.
Ensuite, les constitutionnalistes de premier plan que sont Daniel Turp, Guillaume Rousseau et Patrick Taillon démolissent à tour de rôle de manière convaincante les arguments juridiques mis de l’avant pour contester la Loi sur la laïcité devant les tribunaux. Daniel Turp fait un tour d’horizon de ces arguments, qu’il s’agisse de ceux à l’encontre des clauses dérogatoires, ceux relatifs à la violation des chartes des droits, à l’atteinte aux principes constitutionnels ou au partage des compétences. Le professeur Turp fait voir le problème juridique des opposants, qui est que dans chacune de ces catégories d’arguments, la jurisprudence actuelle penche plutôt pour la validité de la loi, malgré les excès de la liberté de religion individuelle qu’elle contient. La question pour le constitutionnaliste est de savoir si la règle du précédent, qui est normalement respectée et qui joue fortement en faveur de la loi en ce qui concerne par exemple la validité des clauses dérogatoires aux chartes canadienne et québécoise, continuera de s’appliquer ou si un virage jurisprudentiel majeur est en train de s’opérer.
Le professeur Rousseau se concentre sur un argument nouveau à l’encontre de la clause dérogatoire à la Charte canadienne, qui est à l’effet qu’elle doit céder devant l’article 28 de celle-ci. L’article 28, ajouté à la dernière heure par le gouvernement fédéral en 1981 pour satisfaire partiellement les féministes du Canada anglais qui avaient d’avance en horreur les injustices qu’allait présumément commettre la majorité québécoise, garantit l’application du droit à l’égalité indépendamment de toute autre disposition de la Charte. Selon cet argument jamais tranché jusqu’ici, comme les femmes musulmanes pratiquantes sont principalement visées par la loi 21, il y a discrimination entre les sexes que l’article 28 permet de contrer malgré la clause dérogatoire. Cet argument est fallacieux pour deux motifs : d’abord, l’article 28 ne sert qu’à renforcer le droit à l’égalité de l’article 15 et n’a aucune existence indépendante, et si l’article 15 est bloqué par la clause dérogatoire pour éviter toute interprétation abusive de l’égalité, l’article 28 ne peut pas non plus s’appliquer. Plus fondamentalement, il serait paradoxal qu’on puisse invoquer une disposition qui protège l’égalité des genres pour défendre l’inégalité des sexes dans les religions traditionnelles. C’est pourtant la position hallucinante qu’a mise de l’avant l’ex-juge en chef de la Cour d’appel au stade préliminaire.
Il demeure que l’article 27 de la Charte canadienne impose aux tribunaux d’interpréter les droits fondamentaux à l’aune du multiculturalisme, et que le préambule de la Charte mentionne la suprématie de Dieu, deux anomalies que l’on ne voit généralement pas ailleurs dans le monde occidental. Les conventions internationales sur les droits humains ne mentionnent pas le nom de Dieu. La Constitution canadienne introduit dans les faits l’irrationnel religieux parmi ses principes structurants, et ce principe est incompatible avec la rationalité du principe de laïcité. C’est cette incompatibilité qui injecte une incertitude dans les jugements à venir.
Dans son texte, le professeur Taillon souligne que la constitution canadienne, en prévoyant la possibilité d’une clause dérogatoire, instaure un dialogue entre les pouvoirs législatif et judiciaire dans lequel celui-ci n’aura pas toujours le dernier mot. Non seulement ce dialogue interinstitutionnel est légitime, c’est souvent le meilleur moyen de résoudre des problèmes sociaux de grande ampleur. Comme le rappelait un ancien premier ministre du Canada, le pouvoir judiciaire aussi peut se tromper, même si les juges sont nommés par Ottawa. Le professeur Taillon rappelle également la sagesse de la Cour européenne des droits de l’homme, qui donne une marge d’appréciation importante aux États européens, ce qui l’a conduite à plusieurs reprises à valider des restrictions aux droits individuels plus sévères que celles que l’on trouve dans la loi 21. On pourrait ajouter que, de manière surprenante, la jurisprudence de deux cours d’appel aux États-Unis va dans le même sens pour ce qui est de l’interdiction des signes religieux par des enseignants, et que la Cour suprême de ce pays n’a pas accepté de se saisir d’une telle affaire. On pourrait devoir conclure que c’est la Constitution du Canada qui est déraisonnable et non la loi 21, qui est plus conforme à la légalité en droit comparé.
Le mot de la fin appartient au philosophe Normand Baillargeon. Il trace le parcours de l’un des plus brillants défenseurs de la laïcité au début du vingtième siècle, Ferdinand Buisson, auteur d’un manuel majeur de pédagogie pour les enseignants français sous la Troisième République, à l’époque de l’adoption de la célèbre loi fondamentale sur la séparation de l’Église et de l’État de 1905. Buisson, également l’un des fondateurs de la Ligue des droits de l’homme, incarnait la gauche républicaine qui faisait la promotion de la laïcité à l’encontre des éléments conservateurs qui voulaient maintenir la primauté de la religion catholique dans les institutions.
Fait notable, en 1921, Fernand Buisson, reçoit le prix Nobel de la paix, conjointement avec le professeur Ludwig Quidd, pour ses efforts de rapprochement entre les peuples. Il le dédie aux instituteurs et institutrices de l’École publique. Voilà à mon sens une métaphore éloquente du but de la Loi 21, pourtant injustement décriée.
Baillargeon ne manque pas de souligner que les rôles sont aujourd’hui inversés. C’est la nouvelle gauche, qu’il ne croit pas supérieure à l’ancienne, qui défend l’extrémisme religieux et l’oppression traditionnelle de la femme. C’est un gouvernement de centre-droit au Québec qui met de l’avant la laïcité avec l’appui massif du peuple québécois.
Les gauches québécoise et canadienne sont unies dans un même aveuglement, qui est aussi une tragédie.
2021-03-26