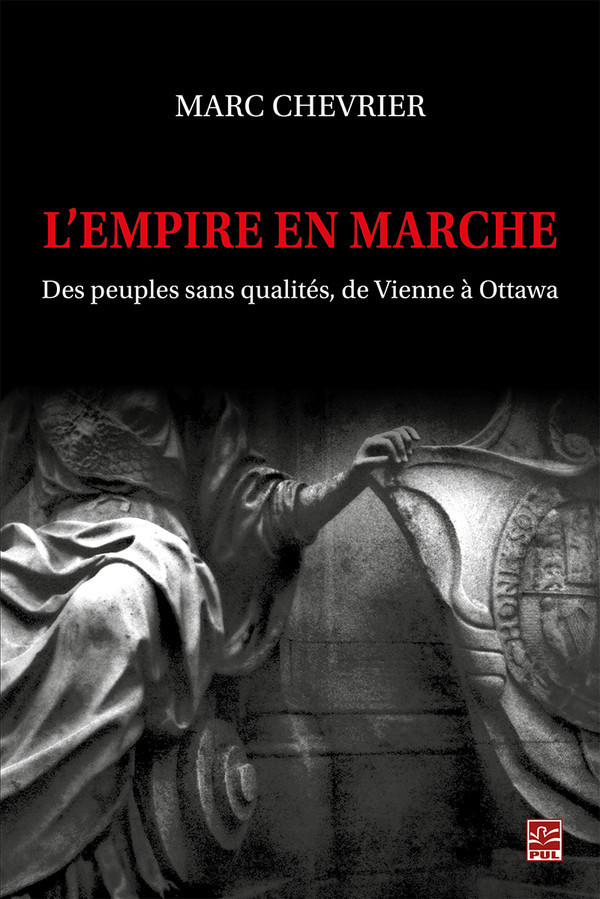Marc Chevrier
L’empire en marche. Des peuples sans qualités de Vienne à Ottawa
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2019, 648 pages
Le politicologue et essayiste Marc Chevrier a fait paraître en novembre 2019 aux PUL, en coédition avec Hermann à Paris, L’empire en marche, des peuples sans qualités de Vienne à Ottawa, un ouvrage magistral dans lequel il jette un regard nouveau et corrosif sur nombre de fédérations dont le Canada. Selon lui, l’empire n’est pas mort, il a simplement changé de nom. Alors que beaucoup considèrent le Canada comme une fédération et, qui plus est, une fédération exemplaire qui prend soin de ses minorités, Chevrier estime au contraire qu’il est un empire.
D’abord, parce que c’est la conquête de la Nouvelle-France et de l’Acadie qui fonde le projet impérial canadien : sans conquête, il n’y a ni Canada ni Empire. Les conquêtes sur lesquelles le Canada repose ont engendré une constitution originelle qui a formaté toutes celles qui ont défini les différents régimes canadiens. Ensuite, Chevrier observe que les acteurs de l’union de 1867 ont eux-mêmes utilisé le terme d’empire. Alexander Morris, membre de l’élite marchande britannique, qui avait lancé l’idée de cette union en 1858, avait vaticiné la formation au Canada d’un « britannic empire ». Macdonald et Brown se référaient à ce concept lorsqu’ils planchaient sur le projet de la Confédération. Le conservateur et père fondateur Hector-Louis Langevin rêvait d’ailleurs que le Canada devienne le plus grand empire du monde.
Chevrier estime que le Canada demeure un empire encore aujourd’hui ; seulement, il voile son identité véritable sous le nom bienveillant de « fédération » qui n’apparaît toutefois nulle part comme tel dans les textes officiels canadiens. Revient répétitivement le terme d’« union », concept clé des lois britanniques usité pour refondre peuples et colonies.
On a aussi tendance à considérer que l’empire ne peut être qu’ancien – on songe par exemple à l’Empire romain – mais, en vérité, loin d’appartenir aux temps anciens, l’empire participe aussi de la modernité, comme l’ont d’ailleurs pensé de nombreux philosophes de Machiavel jusqu’à Hegel, en passant par Montesquieu, Tocqueville et même Arendt. On peine à reconnaître l’empire, car on le croit unique. Les États-Unis constitueraient aujourd’hui le seul empire sur la surface du globe, mais c’est oublier que plusieurs empires peuvent coexister à travers le monde. Chevrier considère que l’Union européenne, le Royaume-Uni et même le Mexique sont des empires, de force variable ; il en est de même pour le Canada, empire libéral, certes faible par rapport à ses voisins, mais fort pour les peuples qu’il domine.
L’essayiste utilise l’idée de « concept sucré » pour imager le fait qu’on pare le fédéralisme de toutes les vertus, il serait garant d’ouverture, de tolérance et de répartition équitable du pouvoir. Mais l’enrobage sucré du fédéralisme laisse la place à un concept salé, celui de l’empire. En effet, comme Chevrier le montre clairement dans la deuxième partie de l’essai, le fédéralisme s’avère la technique juridique privilégiée par les démocraties libérales pour édifier des empires.
À l’instar de l’empire, le régime fédéral tient sur le principe que le gouvernement supérieur gouverne sans administrer. Ce principe est magnifiquement illustré par la crise actuelle de la COVID-19 : le gouvernement fédéral semble planer au-dessus de la mêlée, alors que le Québec plonge les deux mains dans la boue. Québec administre les hôpitaux et les CHSLD ; le palier fédéral, quant à lui, surplombe la scène de haut, en se réservant les grandes tâches législatives et de commandement. En temps de pandémie, il fait valser les milliards ; il joue le sauveur, mais un sauveur qui n’a pas à se salir les mains.
L’empire ne cherche pas nécessairement à tout réaliser par lui-même, et, contrairement à ce qu’on peut penser, il ne désire pas exercer un pouvoir absolu sur toute chose ; les subalternes – dans le cas du Canada, les états provinciaux ou ses nations minoritaires – peuvent très bien s’occuper des basses œuvres. C’est d’ailleurs ce qu’avait compris l’écrivain George Orwell, que Chevrier cite, au sujet de l’Empire britannique en Birmanie : « Ne jamais faire faire à un Européen ce que peut faire un Oriental », écrit l’auteur de 1984. En effet, pourquoi se fatiguer si on peut très bien se fier aux élites locales pour traiter avec les « indigènes » et obtenir leur docile collaboration à la bonne marche de l’empire ?
Deuxièmement, l’empire travaille d’ordinaire à produire de l’unité avec de grands ensembles humains, mais en comptant sur des processus de civilisation autres que politiques. La politique, au sens où l’entend Chevrier, ce sont l’action et la délibération concertées par lesquelles une collectivité se façonne un monde commun où rayonne sa culture. Le Canada a préféré le juridique au politique pour affaiblir les ferments de division ; les tribunaux fédéraux, ont fini par absorber, canaliser et neutraliser les aspirations autonomistes du trublion québécois. À preuve, le renvoi relatif à la sécession du Québec, les jugements de la Cour suprême sur la loi 101 et, enfin, la loi sur la laïcité de l’État du gouvernement Legault qui risque bien de se retrouver devant cette même cour.
L’empire cherche à combattre la force du politique : il ne veut avoir affaire qu’à des individus et non à des nations. C’est pourquoi il entretient un rapport opportuniste avec les religions en s’en faisant le grand défenseur. C’est ce qu’ont compris les autorités britanniques lorsqu’elles se sont concilié l’élite religieuse de la Province of Quebec en proclamant l’Acte de Québec de 1774 qui permet aux Canadiens français de pratiquer leur foi catholique ; c’est ce que l’empire canadien fait actuellement avec sa politique du multiculturalisme, qui réédite l’Acte de Québec sous une forme polythéiste.
L’empire aime à concevoir sa population comme une mosaïque de minorités dont il est le tuteur bienveillant et comme un microcosme qui renferme toutes les croyances. On reconnaît là la célèbre doctrine du quatrième président des États-Unis, James Madison : la meilleure façon de combattre les factions consiste à favoriser un arrangement institutionnel qui les multiplie afin qu’elles se neutralisent. C’est le cas du Canada : une myriade de minorités font valoir leurs droits auprès des cours de l’État fédéral. Il faut à tout prix éviter qu’une minorité se constitue en nation et veuille rompre avec la dépendance qui l’attache au gouvernement central. C’est ce qui est arrivé avec les Québécois lors des référendums de 1980 et de 1995. C’est ce qui est aussi survenu lorsque le Québec a demandé en vain d’être reconnu comme une société distincte. Pour un Pierre-Elliott, partisan acharné d’un multiculturalisme niveleur, c’en était trop : cette revendication menaçait à terme le gouvernement fédéral qui se nourrit de la faiblesse des entités fédérées.
Contrairement à nombre d’historiens qui considèrent que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique apporte une réparation aux torts causés par la Conquête, Chevrier estime que la fondation du Canada en 1867 a marginalisé encore davantage le peuple canadien-français.
Aux yeux de l’essayiste, on a depuis longtemps idéalisé et romancé l’union de 1867, toujours faussement nommée « Confédération ». Plusieurs penseurs nationalistes comme Lionel Groulx l’ont abondamment « sucrée » pour reprendre l’expression de Chevrier ! Comment les Canadiens français ont-ils pu accepter les termes d’un marché aussi peu avantageux ?
En effet, rappelons que le régime de l’union des deux Canadas qui précède l’union de 1867 fonctionne sur un principe binational avec deux premiers ministres à sa tête, l’un francophone, l’autre anglophone ; on parlera des gouvernements de Lafontaine-Baldwin et de Cartier-Macdonald par exemple. Chaque région envoie un nombre égal de représentants au parlement, ce qui constitue un avantage pour les Canadiens français, car la population du Canada-Ouest a dépassé celle du Canada-Est. L’administration y était dédoublée, chaque Canada jouissait de ses lois particulières. Or, l’élite marchande britannique voulait ardemment défaire cette union égalitaire qui conférait au Canada français un veto sur les matières névralgiques à l’Empire telles que commerce, canaux, et immigration. Avec la « Confédération », le Québec ne représente plus qu’une province sur quatre ; il perd son veto. Entre Londres et les « provinces », l’État fédéral absorbe les Canadiens français, définitivement minorisés.
Reprenant une thèse que Stéphane Kelly a développée dans La petite loterie, Chevrier explique que les politiciens bas-canadiens ont accepté l’Union de 1867, car elle était avantageuse pour une bonne partie de l’élite canadienne-française qui recrutait ses membres surtout chez les avocats. Nombre d’entre eux ont alors trouvé des places dans l’administration provinciale, en plus des postes de choix offerts par Ottawa. Les plus talentueux ou les plus arrivistes, comme Georges-Étienne Cartier, ont réussi à se frayer un chemin jusqu’au sommet du gouvernement fédéral.
L’essai de Chevrier n’est pas l’œuvre d’un militant ; il aspire simplement à mieux comprendre la dynamique impériale. Il observe que les indépendantistes ont donné trop de valeur au pacte fédératif de 1867, censé garantir le Québec de toute intrusion dans ses champs de compétence. Deuxièmement, les indépendantistes ont inlassablement dénoncé l’état colonial du Québec, mais les jours de l’ancienne Province of Quebec sont pourtant révolus depuis longtemps : le Québec n’est pas plus une colonie gouvernée par une lointaine métropole qu’une colonie d’Ottawa. Ce qui distingue la domination impériale de sa forme coloniale, c’est que la première fait participer le dominé au gouvernement et lui garantit même des droits.
De plus, la vision multiculturelle de Trudeau père a pénétré les mentalités et séduit beaucoup d’indépendantistes. Cet ardent fédéraliste fut un grand lecteur de lord Acton pour qui tout bon gouvernement doit veiller aux libertés individuelles en disciplinant les peuples et les nations. Acton estimait que des peuples sont plus aptes à la liberté que d’autres : « Les races inférieures s’améliorent en vivant en union politique avec les races intellectuellement supérieures », écrit-il dans un essai intitulé Nationality cité par Chevrier. Trudeau n’a peut-être pas épousé entièrement le racialisme d’Acton, mais pour lui le Québec formait une société incomplète, encline au despotisme et à l’immoralisme ; elle devait donc recevoir une éducation politique dispensée par une nation tutrice, la canadienne-anglaise, si bien qu’à ses yeux le fait français ne pouvait exister que par la concurrence incessante avec l’anglais.
La carrière de Trudeau s’est érigée contre le nationalisme québécois et ses tentatives de donner au Québec un statut particulier qui élargirait son autonomie collective. L’Empire canadien, comme tout empire d’ailleurs, nécessite un ennemi à combattre pour se grandir. Or, selon Chevrier, l’indépendantisme québécois s’est posé en ennemi idéal : il menace l’intégrité de l’empire, mais il est trop faible pour aboutir. Le combat des indépendantistes s’est soldé par des défaites qui ont poussé le régime canadien à raffermir son emprise sur le destin collectif québécois. Les indépendantistes ont certes donné la loi 101 au Québec, mais l’univers de l’enseignement supérieur, si névralgique pour l’existence d’une nation, fonctionne exactement comme l’aurait souhaité Pierre-Elliott Trudeau, c’est-à-dire sur le principe d’un bilinguisme concurrentiel en vertu duquel le français est une langue optionnelle, appuyé sur une liberté de choix instaurée par le Québec lui-même.
Cette concurrence subventionnée frappe aujourd’hui de plein fouet les universités et les cégeps de langue française, en particulier à Montréal, qui voient les meilleurs étudiants du réseau français migrer vers l’enseignement supérieur anglais. De plus, nombre d’établissements du réseau français offrent des formations bilingues ou en anglais seulement. Parallèlement à l’anglicisation de l’enseignement supérieur, de plus en plus de chanteurs et de cinéastes québécois produisent en anglais, après quelques succès d’estime en français. À ce rythme, le français risque de se recroqueviller dans la vie quotidienne. Il risque d’être la langue qu’on utilise avec les proches, la famille, les amis ; il est possible qu’aux yeux des Québécois eux-mêmes, il perde la capacité d’embrasser toutes les dimensions de l’existence, individuelle et collective.
Dans une de ses observations lumineuses, Chevrier écrit :
Aux yeux du Canada, ainsi que de tout autre empire, les peuples et les nations de la planète, si vénérables qu’ils fussent, si anciennes que fussent leur histoire et leur culture, si raffinée qu’ait été leur civilisation, si tenace qu’ait été leur persévérance dans l’existence, finiront tous par se délester d’une partie d’eux-mêmes pour la laisser se dissoudre […] dans un grand cosmos monochrome.
Voilà en effet plus de deux cinquante ans que l’Empire canadien, successeur de l’Empire britannique en Amérique, digère lentement ses prises, dont le Canada français et les nations autochtones ; il les a tout à la fois marginalisées et intégrées, en leur cédant juste ce qu’il faut pour leur survie, quitte à ce qu’elles manifestent, par exaspération, quelques velléités de révolte. Tel est le sort réservé aux peuples sans qualités, qui chérissent dans leur autonomie, provinciale ou tribale, la consolation de leur incomplétude.
La lecture de l’écrivain autrichien Robert Musil a inspiré Chevrier, d’où le sous-titre qu’il a donné à son œuvre : Des peuples sans qualités de Vienne à Ottawa. Dans son grand roman, Musil tente de capter la vie d’un jeune mathématicien souffrant d’une irrésolution presque maladive qui le rend disponible à tout ; il en résulte une dépersonnalisation dans le caractère qui afflige aussi les peuples qui composent la mosaïque de la Cacanie, nom ironique donné à l’Empire austro-hongrois, empire lui-même sans qualités auprès de ses puissants voisins. L’homme sans qualités de Musil a donc permis à l’essayiste de mieux saisir la réalité des peuples minoritaires vivant la condition impériale. Si ces peuples s’avèrent sans qualités, c’est qu’ils sont dépourvus de liberté collective réelle ; leur existence politique, entravée, est souvent nominale, et, en conséquence, ils sont dépourvus de personnalité forte : voués à recevoir la discipline éducatrice d’un régime tutélaire, ils apparaissent sans qualités, inaptes même à les acquérir. Leur culture est reléguée à l’espace privé et à des sphères subalternes. Ils vivent donc intimement, mais sans en prendre conscience, la dissociation entre liberté individuelle et liberté collective, principe sur lequel s’est reposée l’édification des empires selon le baron de Montesquieu. Son fameux ouvrage De l’esprit des lois, que Chevrier cite abondamment, disserte sur l’art de rendre un État esclave, en préservant le citoyen : après une conquête, les peuples peuvent bien mourir ou devenir esclaves de l’empire, pourvu que la liberté des individus soit sauve. C’est à cette loi d’airain libérale que les Canadiens français ont été soumis depuis la Conquête, loi rééditée et raffinée au cours de leur histoire, et notamment lors du rapatriement de la Constitution en 1982. Le Québécois est devenu libre comme individu, capable de s’affranchir de tout, y compris de sa langue et de sa culture, sans voir de lien nécessaire entre cette liberté et celle de sa collectivité nationale qui s’épuise dans l’existence avec des moyens restreints et incohérents.
Bien que, comme je l’ai mentionné, l’essai de Chevrier n’ait pas de visées militantes, l’État-nation en ressort grandi. Chevrier constate simplement qu’on a beaucoup diabolisé la nation – les fédéralistes canadiens et européens sont d’ailleurs passés maîtres à ce jeu –, alors que l’impérialisme, bien plus que le nationalisme, a provoqué les grandes horreurs du XXe siècle. Des esprits lucides, comme le politicologue Gil Delannoi, ont observé par exemple que le projet nazi tenait plus de l’empire que de la nation. D’une part, Hitler visait l’expansion de l’Allemagne : son but consistait à conquérir l’Europe. D’autre part, et contrairement à ce qu’on pourrait s’attendre d’un nationaliste, il éprouvait peu d’amour et de respect pour son propre peuple : il envoya des milliers d’Allemands dans les camps de concentration et ses soldats, pour qui il avait un souverain mépris, mourir en masse sur les champs de bataille.
Chevrier observe toutefois que la nation continue d’exister dans l’empire, même si l’empire est officiellement postnational d’après Justin Trudeau. L’Empire canadien est en réalité plurinational, mais rend simplement la nation majoritaire invisible. Au Canada, la nation canadienne-anglaise, toujours plus majoritaire, exerce une domination de droit et de fait : le régime constitutionnel pérennise sa langue, ses institutions et ses symboles traditionnels comme la monarchie. Cette nation s’est rendue invisible : on ne la voit plus, mais elle n’a pas pour autant cessé d’exister et accroît même son pouvoir au gré des vagues d’immigrants qu’elle a assimilées ! Au contraire, la nation québécoise, plutôt visible, attire sur elle attention et réprobation ; on lui prête les plus sombres desseins. Cette tactique des fédéralistes a bien sûr comme objectif d’affaiblir toute source de nuisance : le Québec sert de bouc émissaire précieux pour fédérer les forces de l’empire.
Jusqu’ici, cette tactique a fonctionné à merveille pour le Canada ! Contrairement à ce que souhaitait un Hubert Aquin, le Québec n’a pas accédé à la liberté politique et, par conséquent, sa culture ne s’étend pas à toutes les dimensions de son existence sociale : elle subsiste certes, mais, tel un élément négatif devant être amendé par un élément positif, laissée dans un état d’inachèvement qui trouvera sa complétude dans le Canada. En régime fédéral – peut-être devrait-on dire impérial – on vante les succès individuels, mais la dimension collective et globale de la culture est marginalisée. Il y a bien sûr des Céline Dion et des Xavier Dolan – l’une chante et l’autre tourne en anglais – mais à côté de ces vedettes aspirées par le firmament américain, ronronnent aussi une éducation supérieure bilingue et une Assemblée nationale empêtrée dans ses tâches d’intendance… Pas de quoi inquiéter le Canada !
L’essai de Chevrier propose une vision corrosive et surtout nouvelle du Canada. En effet, la pensée la plus communément partagée est que le Canada s’est progressivement détaché de l’Empire britannique : il a alors cessé d’être une colonie pour devenir un pays à part entière et, qui plus est, aux yeux de plusieurs commentateurs politiques superficiels, une démocratie exemplaire. Il a certes gardé des symboles monarchiques, mais ceux-ci sont les témoins d’un passé révolu qui n’a plus rien à voir avec le Canada démocratique qu’on connaît aujourd’hui.
Or, Chevrier montre avec brio que le Canada n’a jamais cessé d’être un empire. En effet, contrairement à l’État-nation dont les frontières changent peu, le Canada, avec ses annexions successives de provinces et de territoires, obéit à une logique d’expansion démographique et territoriale, stimulée par une forte immigration. Ce processus d’expansion continue est assez semblable à celui des États-Unis que les pères fondateurs du dominion canadien souhaitaient d’ailleurs égaler. De plus, Chevrier estime que la « Confédération » ne constitue pas l’acte de naissance du Canada ; c’est plutôt la Conquête qui en est l’acte fondateur :
En somme, écrit l’essayiste, dans l’empire […], la force fonde le droit et la prérogative de dire et d’appliquer la justice est consécutive à une violence fondatrice. Les États à l’inverse, bien qu’à l’évidence ils ne puissent pas tous naître pacifiquement, ne sont pas fondés en droit par et dans la violence de la conquête. Ils doivent s’édifier sur un rapport de droit posé par un pacte fondateur, qui borne la puissance gouvernante, l’attache à un principe et lui trouve un vis-à-vis, un peuple, une nation, des sujets, à l’égard duquel la puissance a des obligations.
Cependant, écrit encore Chevrier, « les collectivités et les peuples placés sous domination fédérale subissent une perte irrémédiable [et] des limitations incapacitantes […] ». La constitution régissant la fédération légitime des rapports de domination et entrave l’autonomie des nations minoritaires : « La fédération, c’est l’empire qui prend le visage d’une constitution », écrit-il brillamment.
En somme, l’auteur démystifie la fédération et lui enlève son enrobage sucré, que nombre de politicologues aiment déguster benoîtement, pour qu’on en goûte mieux le salé. Pour ce faire, il a réuni et synthétisé une documentation colossale, mais, en plus, il fait un bon usage de la littérature. Ce n’est pas la première fois que l’essayiste cherche son inspiration du côté des arts : son œuvre précédente, La république québécoise, épousait la structure d’une composition musicale. Cette fois, c’est la littérature qui irrigue profondément son ouvrage. Des grands auteurs, il retient une langue riche, superbe, dépourvue d’anglicismes et d’expressions jargonneuses, et de Musil, plus particulièrement, il retient le scepticisme et l’ironie, mais aussi l’effort qui rend possible un travail de longue haleine et une grande œuvre.
Nicolas Bourdon
Professeur de français, collège Bois-de-Boulogne