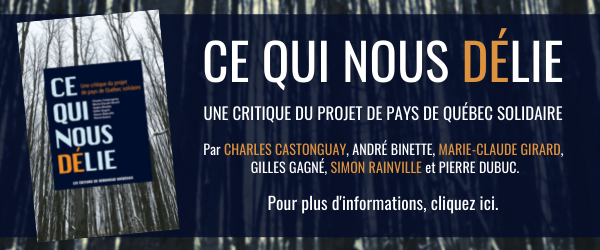Le français est en crise au Canada depuis les années 1960. Crise attribuable à Pierre Elliott Trudeau. Aveuglé par sa volonté d’abattre le nationalisme canadien-français devenu québécois, Trudeau a détourné le Canada de la seule politique susceptible d’assurer au français un avenir enviable en son sein, soit un bilinguisme territorial semblable à celui en vigueur en Suisse ou en Belgique.
Des études éclairantes
Il aurait dû en être autrement. Dès la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (CRBB), des chercheurs dissipent l’illusion de populations francophones viables d’un océan à l’autre. L’ingénieur Richard J. Joy présente à la Commission une analyse d’un siècle de recensements depuis 1867, qu’il reprend dans Languages in Conflict: The Canadian Experience (1967).
Il décrit l’urbanisation et l’assimilation croissantes des minorités francophones non limitrophes du Québec et en conclut que « deux langues de force inégale ne peuvent coexister en contact intime ; la plus faible doit, inéluctablement, disparaître » (je traduis).
Au même moment, le démographe Robert Maheu dépose sa thèse de maîtrise, reprise par la suite dans Les francophones du Canada, 1941-1991 (1970). Il prévoit, lui aussi, que les francophones se concentreront progressivement au Québec. Bref, la réalité linguistique commande une politique de bilinguisme territorial qui s’emploierait, d’abord et avant tout, à consolider le caractère français du Québec.
La vision de Trudeau
Trudeau et son mentor Frank Scott, membre de la CRBB, veillent cependant au rejet du bilinguisme territorial. « [Dans] l’Amérique du Nord contemporaine, la population est si mobile qu’il semblerait irréaliste d’adopter un principe d’une telle rigidité, fût-il considéré comme souhaitable » (Rapport de la CRBB, tome 1, 1967 : je souligne). D’après la Commission, la mobilité des individus prime ainsi sur sa propre raison d’être, soit de sécuriser le français ! Elle recommande plutôt le libre-échange linguistique, c’est-à-dire le libre choix individuel de l’anglais ou du français et la libre circulation des personnes d’un océan à l’autre.
Trudeau concrétise son refus du bilinguisme territorial en lançant, en 1969, la transformation de Hull en copie conforme d’Ottawa. La CRBB réitère à l’occasion que seule convient à la région de la capitale une politique « qui assure effectivement une liberté de choix maximale de son lieu de résidence sans avoir à composer avec des inconvénients linguistiques » (Rapport, tome 5, 1970 : je traduis et souligne).
En 1973 Trudeau charge Douglas H. Fullerton, président démissionnaire de la Commission de la capitale nationale (CCN) qui veille à la réingénierie identitaire de l’Outaouais, d’examiner comment mieux gérer la région Ottawa-Hull. Le projet d’un district fédéral semblable à Washington, D.C. circule. La CRBB avait notamment avancé qu’un « Territoire de la capitale ouvrirait la voie à une égalité linguistique complète » (ibid.). Vivement le contact intime entre francophones de Hull et anglophones d’Ottawa.
Le district fédéral
Diffusées fin 1973, les données du recensement de 1971 révèlent l’anglicisation croissante des francophones à Ottawa et la fragilité du français même dans l’Outaouais. Cela frappe Fullerton, au courant aussi des travaux de Joy. Dans son rapport La Capitale du Canada : Comment l’administrer (1974), il rejette l’idée d’un district fédéral, et recommande une politique linguistique fondée sur le principe de concentration raisonnable, qui consiste en gros à promouvoir le regroupement territorial des francophones.
« La population québécoise de la région s’inquiète, à juste titre, de la menace que représente pour la langue et la culture l’‘‘invasion’’ de l’Outaouais par une affluence massive d’anglophones travaillant dans les nouveaux édifices fédéraux à Hull et par le nombre des anglophones qui achètent ou louent une maison du côté du Québec […] Le principe de concentration raisonnable risque de paraître rébarbatif à première vue. On y verra l’érection de murailles là où l’on tente de les démolir. À cela, je rétorquerai que l’édification de la compréhension mutuelle entre les cultures n’est possible que si les parties éprouvent un sentiment de sécurité quant à leur propre identité, que ce n’est que lorsqu’une communauté ne craint plus rien qu’elle peut s’épanouir et que la concentration ou le regroupement représente le meilleur moyen de contrer l’assimilation » (je souligne).
Des anglophones de bonne foi, ça existe. La concentration réduit en effet le degré de contact. « Good fences make good neighbours », dit-on dans la langue de Joy. De bonnes clôtures font de bons voisins.
La CCN désavoue aussitôt Fullerton : « Une interaction plus marquée des deux côtés de la rivière hâterait l’avènement d’une Capitale plus représentative d’une société canadienne reposant sur le principe que d’étroites relations économiques et sociales ne peuvent que renforcer l’identité culturelle » (La Capitale de demain, 1974). Encore le contact intime. C’est-à-dire le melting-pot.
Le rempart indépendantiste s’étiole
Le sentiment croissant d’aliénation parmi la population francophone contribue à l’élection en 1976 de députés indépendantistes dans Hull et Gatineau. L’invasion stoppe net. Le gouvernement Lévesque, bien renseigné sur l’anglicisation à Montréal et dans l’Outaouais, instaure en 1977 l’affichage commercial en français, ainsi que la clause Québec. Bienvenue aux Anglo-Ontariens qui acceptent le français comme langue publique commune. Et qui veulent bien inscrire leurs enfants en immersion française… à l’école française.
Trudeau réplique sur-le-champ. Une semblable politique territoriale signerait la fin du Canada (Un choix national : exposé du Gouvernement du Canada pour une politique linguistique nationale, 1977). En clair, il entend sacrifier le français sur l’autel de l’unité canadienne. Voilà la véritable raison pour laquelle il abhorre le bilinguisme territorial. Le chat aura mis dix ans à sortir du sac.
Ottawa et sa Cour suprême abattent par la suite les éléments territoriaux essentiels de la loi 101. En particulier, la Loi constitutionnelle de 1982 remplace la clause Québec par sa clause Canada, laquelle invite tous les Michael Rousseau de ce monde à venir se comporter à Montréal et dans l’Outaouais comme s’ils étaient en Ontario.
Pendant un temps encore, la ferveur indépendantiste tient à distance les migrants interprovinciaux insensibles au caractère français du Québec. Mais les vannes sont maintenant ouvertes. Entre 2016 et 2021, davantage d’Anglo-Canadiens sont entrés au Québec que d’Anglo-Québécois qui en sont sortis. Encore une première historique.
Depuis les travaux de Joy et de Fullerton, un demi-siècle supplémentaire de recensements a confirmé une anglicisation du Canada et du Québec qui crève aujourd’hui les yeux. La politique de Trudeau s’est avérée toxique pour le français. Il n’y a que deux remèdes à sa crise, devenue hyper-aiguë. Ou le Canada refonde sa politique sur une base territoriale et participe à la francisation de l’espace public québécois. Ou le Québec se donne le pouvoir de faire du français sa langue commune.
Le français étouffe. Depuis longtemps. Très longtemps. Pour qu’il puisse enfin s’épanouir, le Québec et le reste du Canada devront, sous une forme ou une autre, faire chambre à part.